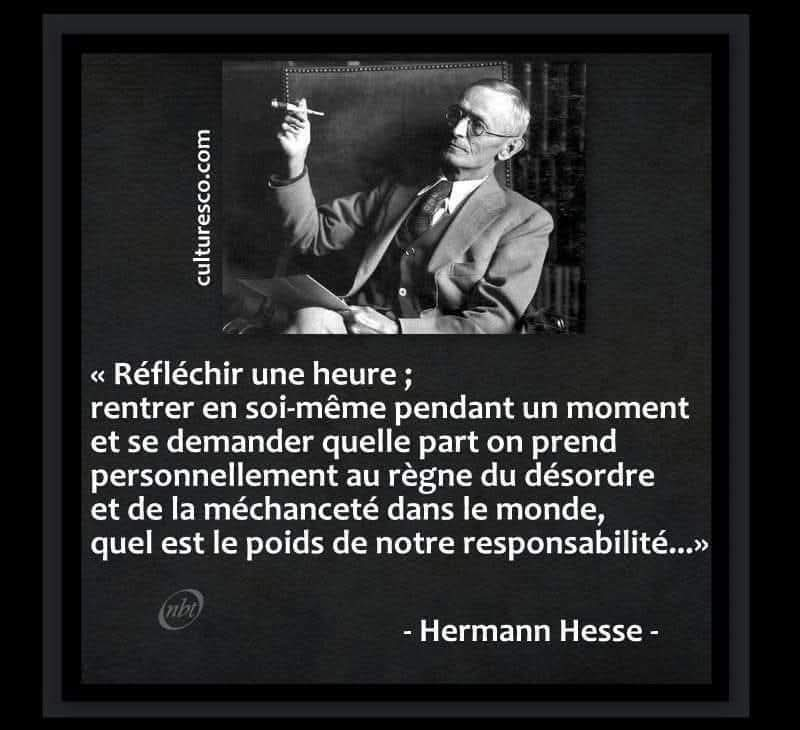Par Franck Essi

Il est des concepts qui dérangent, qui bousculent, qui ne vous laissent pas indemnes. Celui de la banalité du mal, forgé par Hannah Arendt, est de ceux-là. Il ne se contente pas d’ajouter un chapitre à la philosophie politique contemporaine. Il nous oblige à regarder en face une vérité qui glace : l’horreur ne vient pas toujours des monstres, mais des hommes et des femmes ordinaires. Des gens normaux, polis, bien élevés, qui obéissent, qui s’adaptent, qui exécutent.
Arendt n’est pas une théoricienne du mal dans l’absolu. Elle n’écrit pas sur les démons, mais sur les bureaucrates. Quand elle assiste au procès d’Adolf Eichmann, haut fonctionnaire nazi responsable de la logistique de la déportation de millions de Juifs, elle ne trouve pas un bourreau sadique. Elle trouve un homme terne, sans épaisseur, sans haine, sans passion. Un homme qui « ne pensait pas ». Un fonctionnaire zélé, qui répétait : « Je n’ai fait qu’obéir aux ordres. »
Et c’est là le vertige : le mal peut être commis non par cruauté, mais par conformisme. Il peut être accompli sans rage, sans haine, sans même conscience. Il devient un travail, une tâche, une procédure. Une routine.
Ce que Arendt nomme la banalité du mal, c’est cette capacité des systèmes totalitaires – mais aussi des bureaucraties froides, des régimes indifférents, des administrations déshumanisées – à faire du crime une fonction. À produire des hommes et des femmes capables de tuer, d’opprimer, de nuire… sans jamais se sentir responsables. Sans même se poser de questions.
Et chez nous ?
On aurait tort de croire que cette idée ne concerne que l’Allemagne nazie. L’Afrique contemporaine regorge de figures d’Eichmanns postcoloniaux. Des agents d’État qui torturent sans état d’âme. Des magistrats qui rendent des jugements iniques avec le sourire. Des médecins qui laissent mourir par absence de moyens mais aussi par indifférence. Des policiers qui rackettent comme on remplit une fiche. Des fonctionnaires qui signent des ordres iniques en disant : « C’est le chef qui m’a demandé. »
Dans nos administrations, dans nos casernes, dans nos ministères, dans nos préfectures, dans nos tribunaux, dans nos cellules politiques… Combien de décisions absurdes, inhumaines, arbitraires, sont justifiées non par méchanceté, mais par routine ? Combien de destins brisés au nom du service ? Combien d’atrocités commises parce que « c’est comme ça que ça se fait » ?
La banalité du mal, c’est aussi quand on arrête un journaliste ou un militant pacifique sans réfléchir. Quand on refuse un soin, une bourse, une justice parce qu’il manque un tampon. Quand on signe un marché fictif, quand on fait exécuter un ordre injuste, quand on applique une loi scélérate, sans jamais se demander si c’est juste. Si c’est humain.
Penser, c’est résister
Arendt ne nous donne pas une excuse. Elle nous donne une alerte. Ce n’est pas Eichmann qu’elle veut comprendre. C’est nous. Elle veut nous rappeler que le pire peut naître de l’absence de pensée. Que penser, c’est résister. Que réfléchir à ce qu’on fait, à ce qu’on accepte, à ce qu’on cautionne, est le premier acte de courage dans une société malade.
Elle nous dit : Ne croyez pas que vous êtes à l’abri. Le mal n’a pas besoin de monstres. Il lui suffit de l’indifférence. De l’obéissance. De la déresponsabilisation.
Voilà pourquoi nous devons éveiller les consciences. Former des citoyens qui pensent. Qui doutent. Qui désobéissent parfois. Non pour le plaisir du désordre, mais au nom de la dignité. De l’humanité.
Mon intime conviction : La banalité du mal est un miroir.
Elle nous oblige à nous regarder et à nous demander : Et moi ? Où suis-je complice par ma passivité ? Où est-ce que je laisse passer l’inacceptable au nom du confort, du silence, de la peur ?
Refaire société commence peut-être par-là : ne plus banaliser ce qui nous déshumanise.
#LesIdéesComptent
#NousAvonsLeChoix
#NousAvonsLePouvoir
#AllumonsNosCerveaux