Par Franck Essi
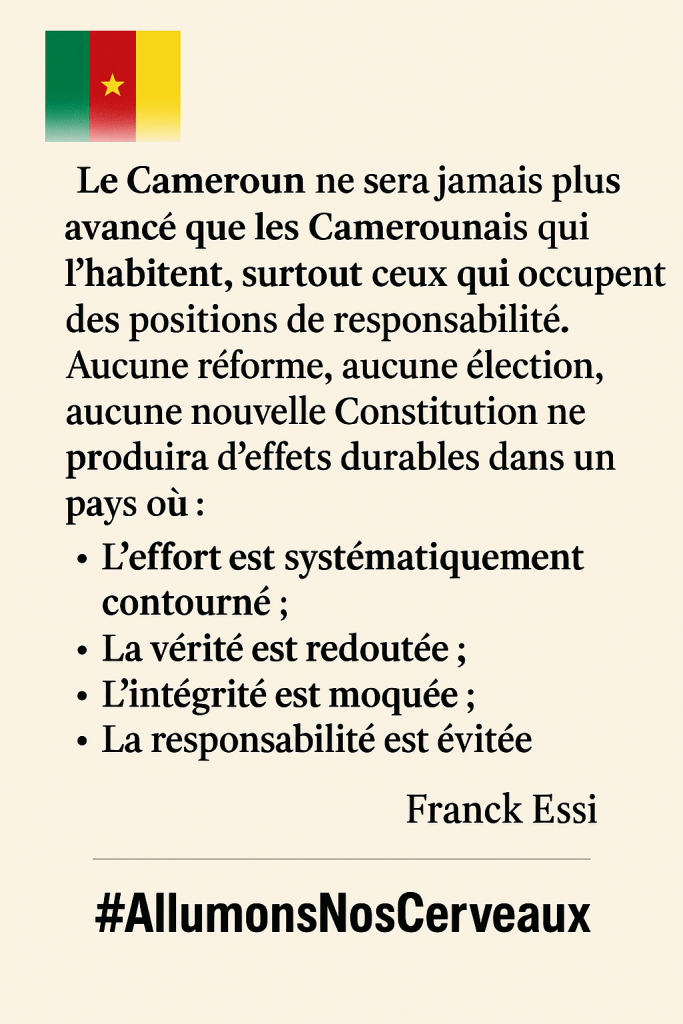
—
Le Cameroun donne l’impression d’un pays qui fonctionne encore, mais de plus en plus à vide. Les administrations ouvrent, mais ne résolvent pas. Les services publics existent, mais déçoivent. Les corporations professionnelles se mobilisent, mais peinent à faire régner un ordre interne durable. Quant au citoyen, il oscille entre lucidité et résignation, colère et fatalisme.
On invoque volontiers les raisons structurelles : héritage colonial, centralisation excessive, économie de rente, absence d’alternance politique. Ces explications sont réelles ; elles ne sont pas suffisantes.
Car à la racine de nos blocages, une vérité plus dérangeante s’impose : le Cameroun traverse avant tout une crise morale, une crise du sens, une crise de la responsabilité. Fabien Eboussi Boulaga, dans La Crise du Muntu, décrivait déjà cette décomposition intérieure où l’individu se dérobe à lui-même, où les valeurs cessent d’être des forces vivantes pour devenir des mots creux.[1]
Le philosophe Hubert Mono Ndjana a résumé d’une formule ce que nous vivons aujourd’hui :
« Au Cameroun, on a écarté la norme et normalisé l’écart. »
La phrase est terrible, parce qu’elle est exacte. La transgression n’est plus l’exception qui choque : elle est devenue la manière ordinaire de faire fonctionner le pays.
Comprendre cela, c’est comprendre que la reconstruction du Cameroun ne pourra être ni seulement institutionnelle, ni seulement économique. Elle devra être – d’abord – morale et éthique.
—
Quand le moral se fissure, tout le reste s’effondre
Depuis plusieurs décennies, le Cameroun s’est habitué à un mode de fonctionnement où :
- La loyauté personnelle prime sur la compétence ;
- La survie administrative vaut plus que le service rendu ;
- La “paix sociale” se confond avec le silence face aux dérives ;
- La ruse est mieux récompensée que l’intégrité.
Ce système produit des réflexes qui deviennent culturels :
- Des dossiers enterrés dans les bureaux, faute de “relance appropriée” ;
- Des marchés publics attribués selon l’affinité ou l’appartenance ;
- L’arbitraire dans certains postes de police ou brigades de gendarmerie ;
- Des hôpitaux publics partiellement privatisés de fait par des pratiques informelles ;
- Des ordres professionnels minés par la lutte d’influence, le carriérisme et la peur de sanctionner leurs membres.
Dans ce contexte, des expressions comme « On va faire comment ? », « Le Cameroun c’est le Cameroun » ou « Pour moi quoi dedans ? » ne sont pas de simples tics de langage : elles disent une philosophie. Elles installent dans les esprits l’idée que l’effort est vain, que la règle est facultative, que l’intégrité est naïve.
Achille Mbembe l’a montré à propos des régimes postcoloniaux : lorsqu’une société cesse de se penser comme responsable de son propre destin, l’espace politique se transforme en scène de survie, de ruse et de spectacle, plutôt qu’en lieu de projet collectif.[2] Nous y sommes.
—
L’histoire mondiale le montre : les nations se reconstruisent d’abord moralement
L’idée centrale est simple : avant que les infrastructures, les institutions ou l’économie ne se relèvent, ce sont les consciences qui doivent se redresser. Trois exemples l’illustrent avec force : le Japon, l’Allemagne et le Rwanda.
1. Le Japon : reconstruire l’honnêteté avant de reconstruire les routes
En 1945, le Japon est un pays détruit : villes rasées, économie à terre, institutions discréditées, traumatisme national immense. Pourtant, en moins de trente ans, il devient l’une des premières puissances économiques du monde.
Dans Embracing Defeat, l’historien John W. Dower montre que la priorité des élites japonaises de l’après-guerre n’a pas été seulement matérielle. Elle a été morale.[3]
- À l’école, on met au centre l’autodiscipline, le respect de la règle, le sens du devoir et de la communauté. Les élèves nettoient leurs classes eux-mêmes, apprennent la ponctualité, la coopération, la responsabilité.
- Dans les entreprises, se développe une culture de la loyauté, de l’effort collectif, de la qualité irréprochable. L’idée n’est pas seulement de produire, mais de bien produire, avec honneur.
- Dans l’État, une politique anticorruption est progressivement mise en place ; la honte publique associée au scandale joue un rôle dissuasif puissant.
Cette “infrastructure morale” génère une confiance sociale qui rend possible le décollage économique. Les routes, les usines, les ports viennent après. Ce qui vient d’abord, c’est la décision collective de faire de la règle et du travail bien fait des piliers de la dignité nationale.
2. L’Allemagne : la responsabilité comme fondation du renouveau
L’Allemagne de 1945 est un champ de ruines, moralement encore plus que matériellement. Pourtant, en deux décennies, la République fédérale devient un moteur de l’Europe.
La clé, comme l’ont montré les travaux d’Ian Buruma (The Wages of Guilt) et de Konrad Jarausch (After Hitler: Recivilizing Germans, 1945-1995), est ce qu’on a appelé la Vergangenheitsbewältigung – le “travail d’affrontement avec le passé”.[4][5]
Très concrètement :
- Le système judiciaire est réorganisé pour rompre avec la logique totalitaire ;
- Une partie de l’administration est épurée (même imparfaitement) ;
- L’école est refondée autour d’une éducation civique rigoureuse : droits humains, responsabilité individuelle, critique de l’autorité ;
- La question de la culpabilité et de la participation au régime nazi est débattue publiquement.
Il ne s’agit pas d’une morale abstraite : il s’agit de reconnaître que l’on ne peut reconstruire une nation solide sur un mensonge. La vérité devient un acte politique. La responsabilité, un apprentissage collectif. Ce socle moral explique en grande partie la stabilité démocratique allemande.
3. Le Rwanda : discipline civique, mémoire et intégrité comme projet national
En 1994, le Rwanda est dévasté par un génocide d’une ampleur inouïe. Beaucoup d’analystes annoncent un État failli, voire la disparition du pays comme entité viable. Pourtant, en moins de trente ans, le Rwanda se redresse à un rythme que d’aucuns jugeaient impossible.
Les recherches de Phil Clark sur les juridictions gacaca et de Timothy Longman sur la justice et la réconciliation post-génocide montrent trois piliers essentiels du redressement moral rwandais :[6][7]
- Une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption : administrations réformées, sanctions rapides, contrôle strict des fonctionnaires, y compris de haut rang. L’intégrité devient un critère de crédibilité de l’État.
- Un travail de mémoire obligatoire : visites scolaires aux mémoriaux, intégration de l’histoire du génocide dans les programmes, commémorations nationales. La mémoire n’est pas laissée aux historiens : elle devient une pédagogie citoyenne.
- Une discipline civique organisée : le Umuganda – journée mensuelle de travail communautaire – n’est pas seulement un nettoyage des quartiers ; c’est une pratique régulière de responsabilité partagée.
Le modèle rwandais est loin d’être parfait, et ses aspects autoritaires doivent être interrogés. Mais il montre une chose : un État peut décider de faire de la morale publique un pilier de sa reconstruction, et obtenir des résultats tangibles en matière d’ordre, de confiance et d’efficacité.
—
Le Cameroun : une érosion lente du sens, mais des ressources morales réelles
Le Cameroun n’a pas connu de rupture cataclysmique comparable à celles du Japon, de l’Allemagne ou du Rwanda. Nous vivons autre chose : une érosion lente du sens, une dégradation progressive des normes, une accumulation de petites lâchetés et de grands renoncements.
Pourtant, notre histoire offre des ressources éthiques considérables.
1. Des sociétés précoloniales dotées de mécanismes moraux robustes
Dans de nombreuses sociétés précoloniales, les autorités traditionnelles combinaient pouvoir spirituel et temporel, mais dans un cadre de responsabilité collective : la parole donnée engageait la dignité du clan ; la honte publique sanctionnait les comportements déviants ; la réparation et la médiation coutumières jouaient un rôle central.[8]
Ces systèmes n’étaient pas idylliques, mais ils montraient que la règle sociale était vécue comme une obligation partagée, non comme une simple contrainte extérieure.
2. Les luttes nationalistes : discipline, sacrifice, cohérence
Les mouvements de libération des années 1940-1950, au Cameroun comme ailleurs, ont incarné un éthos de discipline, de sens du sacrifice, de cohérence entre discours et vie personnelle. Que l’on pense aux militants de l’UPC refusant la compromission, aux réseaux de résistance organisant la lutte dans des conditions extrêmement difficiles : la morale n’était pas un supplément, mais un carburant.
3. Les premières générations de fonctionnaires
Les témoignages des années 1960-1980 abondent : instituteurs, magistrats, infirmiers, ingénieurs ont exercé leurs fonctions avec une haute idée du service public. On pouvait être fier d’être “fonctionnaire”, parce que cela signifiait quelque chose en termes d’honneur et de rigueur.
Le problème, aujourd’hui, n’est pas l’absence de valeurs.
C’est leur abandon progressif, puis leur relégation au rang de décor.
—
Pourquoi la crise est morale et structurelle – et pourquoi il faut commencer par le moral
Dire que la crise est morale ne signifie pas que tout serait une affaire d’“âme” individuelle. Comme l’ont montré Achille Mbembe et Marcien Towa, les systèmes politiques produisent les comportements qu’ils encouragent ; mais, en retour, les comportements finissent par renforcer les systèmes.[2][9]
Autrement dit :
- Un État qui ne sanctionne pas l’impunité fabrique de l’irresponsabilité ;
- Des citoyens qui renoncent à toute exigence morale renforcent un État sans scrupules.
Le cœur du propos n’est donc pas : “changeons les cœurs, et tout ira mieux”.
Il est : “sans réarmement moral, aucune réforme institutionnelle ne tiendra”.
C’est ce que montrent le Japon, l’Allemagne et le Rwanda : les textes de loi ont compté, mais c’est la transformation des comportements, des repères, des imaginaires qui a permis la stabilité.
—
Que signifie « réarmer la conscience » au Cameroun – et par où commencer ?
Le réarmement moral n’est pas un sermon. C’est un chantier politique. Au Cameroun, il peut s’articuler autour de trois niveaux : individuel, communautaire, institutionnel.
1. Niveau individuel : sortir du “on va faire comment ?”
Des questions simples, mais décisives :
- Est-ce que je refuse, concrètement, de payer ou de recevoir un pot-de-vin ?
- Est-ce que je tiens la parole donnée, même lorsqu’elle ne m’arrange plus ?
- Est-ce que je travaille sérieusement, même quand personne ne regarde ?
- Est-ce que je protège la vérité, ou est-ce que je la tords pour me protéger moi-même ?
Par où commencer ?
- Par une hygiène personnelle de la vérité (ne pas mentir “par réflexe”).
- Par des refus assumés (dire non à un arrangement illégal, même “petit”).
- Par des gestes positifs : aider un collègue à bien faire, protéger un plus vulnérable.
Ce sont des actes minuscules, mais ils fissurent le système de l’intérieur.
2. Niveau communautaire : familles, associations, partis, églises
Les communautés sont des lieux puissants de socialisation morale.
Par où commencer ?
- Dans les familles : cesser de glorifier la “réussite par tous les moyens”, valoriser la probité, raconter des histoires de courage plutôt que des exploits de triche.
- Dans les associations et partis politiques : adopter de vraies chartes éthiques, limiter le cumul de fonctions, publier les comptes, organiser des bilans publics réguliers.
- Dans les églises et mosquées : exiger la cohérence entre discours et pratiques, dénoncer les dérives internes (abus financiers, manipulation spirituelle), mettre en avant la justice, pas seulement la prospérité individuelle.
3. Niveau institutionnel : État, école, justice, ordres professionnels
C’est ici que la pédagogie des exemples étrangers est la plus utile.
a) L’école : “fabrique de caractère”
À l’image du Japon ou de l’Allemagne, l’école camerounaise doit redevenir un lieu où l’on forme des consciences, pas seulement des candidats aux concours.
Par où commencer ?
- Réintroduire une éducation civique réelle, basée sur des cas pratiques, des débats, des projets collectifs.
- Lutter fermement contre les notes monnayées, les tricheries organisées.
- Instituer des formes de service communautaire scolaire, pour créer un réflexe de contribution.
b) La justice : rendre la norme crédible
Sans justice digne de ce nom, la règle reste théorique.
Par où commencer ?
- Assurer la publicité des décisions, l’accès aux jugements, la transparence des procédures.
- Protéger les magistrats qui font leur travail avec indépendance.
- Faire des grands dossiers de corruption des affaires exemplaires, où la sanction est claire et comprise par tous.
c) La fonction publique : remettre de l’ordre dans l’État
Comme au Rwanda avec la tolérance zéro, il faut envoyer un signal net.
Par où commencer ?
- Appliquer les textes déjà existants sur l’assiduité, le respect des délais, les sanctions disciplinaires.
- Mettre en place quelques “cas tests” : un département ministériel, une région, un hôpital, une commune pilote où l’on applique réellement les règles et où l’on mesure les résultats.
- Associer les citoyens au contrôle : tableaux d’affichage des délais, mécanismes de plaintes accessibles, audits publics.
—
Les minorités lucides : les vrais moteurs du changement
Dans tous les exemples historiques, ce ne sont pas des majorités massives qui initient les ruptures morales, mais des minorités lucides :
- Des enseignants qui refusent de vendre des notes ;
- Des médecins qui soignent selon l’éthique, non selon l’enveloppe ;
- Des juges qui appliquent la loi, même dans des dossiers sensibles ;
- Des journalistes qui enquêtent avec sérieux ;
- Des militants qui refusent les “compromissions intelligentes”.
Au Cameroun, ces minorités existent. Elles sont parfois isolées, découragées, invisibilisées. Elles sont pourtant les réserves morales du pays.
Les protéger, les relier, les mettre en lumière, c’est déjà commencer le redressement.
—
Mon intime conviction : un pays ne vaut jamais plus que ses choix moraux
Le Cameroun ne sera jamais plus avancé que les Camerounais qui l’habitent, surtout ceux qui occupent des positions de responsabilité. Aucune réforme, aucune élection, aucune nouvelle Constitution ne produira d’effets durables dans un pays où :
- L’effort est systématiquement contourné ;
- La vérité est redoutée ;
- L’intégrité est moquée ;
- La responsabilité est évitée.
Le réarmement moral n’est pas un supplément d’âme.
C’est la condition même de notre renaissance collective.
Le Japon l’a fait.
L’Allemagne l’a fait.
Le Rwanda, à sa manière, l’a fait.
Le Cameroun le peut.
À condition d’accepter d’abord de regarder sa vérité en face :
nous avons écarté la norme,
nous avons normalisé l’écart.
Il est temps de renverser cette logique.
De faire de la règle non plus un obstacle, mais une protection.
De faire de la conscience non plus un handicap, mais une force.
C’est le chantier le plus difficile.
Mais c’est le seul qui ouvre un avenir.
#CeQueJeCrois
#LesIdéesComptent
#NousAvonsLeChoix
#NousAvonsLePouvoir
#AllumonsNosCerveaux
Références :
[1] Fabien Eboussi Boulaga, La Crise du Muntu, Présence Africaine, 1977.
[2] Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Karthala, 2000.
[3] John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, W.W. Norton/New Press, 1999.
[4] Ian Buruma, The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan, Vintage, 1994.
[5] Konrad H. Jarausch, After Hitler: Recivilizing Germans, 1945–1995, Oxford University Press, 2006.
[6] Phil Clark, The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda, Cambridge University Press, 2010.
[7] Timothy Longman, Memory and Justice in Post-Genocide Rwanda, Cambridge University Press, 2017.
[8] Voir par exemple : “Traditional Authorities and Decentralisation in Cameroon”, International Journal of Research and Innovation in Social Science, vol. 5, n°12, 2021.
[9] Marcien Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, Éditions Clé, 1971.
