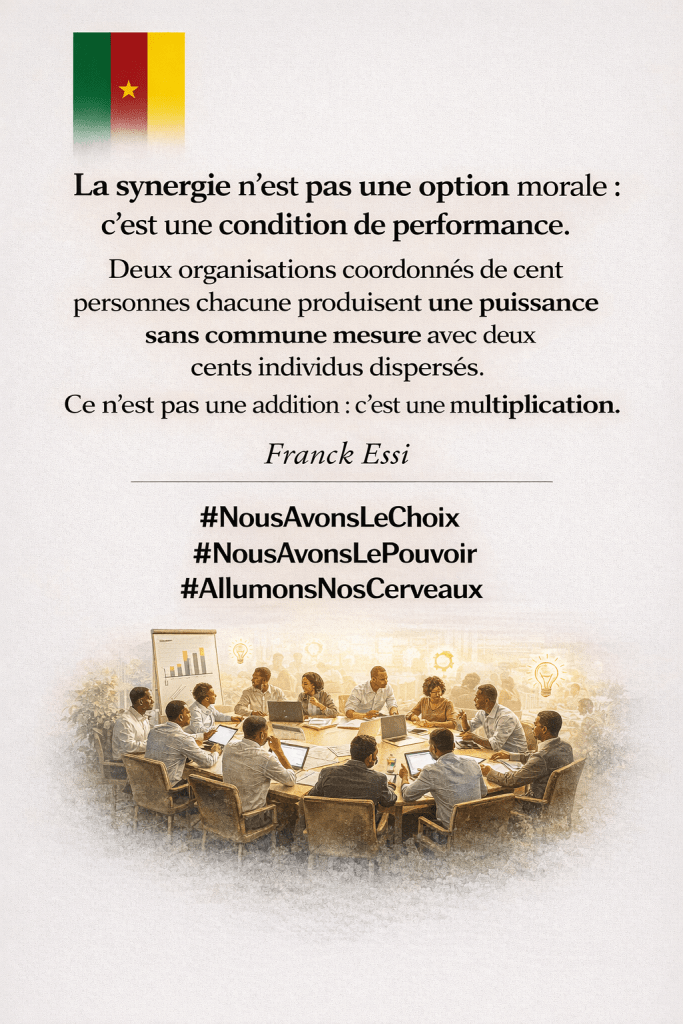—
Quel que soit le domaine observé — politique, affaires, sport, médias, syndicats, associations, initiatives citoyennes — un constat s’impose avec une régularité troublante : les Camerounaises et les Camerounais peinent à faire bloc pour défendre durablement des intérêts communs.
Les talents existent. Les idées abondent. Les initiatives foisonnent.
Mais elles avancent, le plus souvent, en ordre dispersé — comme si la dispersion était notre mode d’organisation par défaut.
—
Le paradoxe du contrôle individuel
Tout se passe comme si beaucoup préféraient rester propriétaires exclusifs d’une petite entreprise qui rapporte 100 francs CFA, plutôt que de devenir actionnaires d’un projet collectif capable de générer — pour chacun — dix fois plus de valeur. Le contrôle individuel, même dérisoire, paraît plus rassurant que la réussite collective, pourtant plus prometteuse.
Cette logique n’est pas un simple “trait de caractère national”. Elle s’enracine dans des strates profondes de notre histoire et de nos structures sociales.
L’héritage colonial a codifié la division — géographique et politique — comme outil de domination. Après l’indépendance, la centralisation et la concentration du pouvoir ont renforcé une méfiance durable envers les structures collectives autonomes, souvent perçues comme des menaces potentielles. Et dans la matrice même de nos organisations sociales — réseaux de parenté, hiérarchies lignagères, systèmes de notabilité — demeure une tension ancienne entre l’intérêt du groupe et le prestige personnel du leader.
Résultat : au lieu d’assister à des rapprochements, à des fusions d’initiatives, à la construction patiente d’organisations solides et crédibles, on observe une fragmentation chronique. Les projets se scindent, les leaderships se concurrencent, les structures se démultiplient — toutes trop faibles, trop isolées, trop vulnérables face aux enjeux réels du moment.
—
L’illusion de l’excellence solitaire
Le paradoxe est cruel : nous sommes souvent individuellement brillants, mais collectivement inefficaces.
Nous produisons des leaders, mais rarement des équipes durables.
Des projets, mais peu d’institutions solides.
Des mobilisations ponctuelles, mais presque jamais des dynamiques de long terme.
C’est ainsi que nous peinons à bâtir de grands partis politiques enracinés, de grandes entreprises capables de structurer des filières, de grands médias influents, de grands festivals culturels ou sportifs à portée internationale. Et lorsque de telles expériences voient le jour — dans la société civile, dans l’entrepreneuriat ou dans la culture — elles souffrent souvent du même mal : leur caractère éphémère.
Les désaccords internes, les conflits d’ego, la méfiance réciproque, l’incapacité à gérer le temps long finissent par l’emporter sur la vision initiale. Ce qui devait durer se dissout. Ce qui devait grandir s’éteint. Même les contre-exemples — ces rares structures qui ont tenu — restent souvent fragiles, exposées aux chocs internes et aux pressions externes.
—
Les mécanismes qui entretiennent la fragmentation
Pour comprendre cette dynamique, il faut regarder au-delà de l’observation superficielle. Plusieurs mécanismes la perpétuent.
La méfiance institutionnalisée, d’abord, héritée de décennies de manipulation politique, fabrique un réflexe viscéral : celui qui cède du contrôle risque d’être spolié. Chacun mémorise les trahisons passées — coalitions effondrées, alliances rompues, promesses non tenues — et préfère construire son espace personnel plutôt que s’investir dans une structure collective où il craint d’être marginalisé ou instrumentalisé.
Le calcul rationnel en contexte d’insécurité, ensuite. Dans un environnement politiquement répressif, économiquement instable et institutionnellement fragile, les gains collectifs semblent incertains. L’individu sécurise donc son petit empire : le risque collectif paraît disproportionné face au coût potentiel de l’engagement.
La psychologie de la domination personnelle, enfin. Pour beaucoup, diriger signifie contrôler, décider seul, être l’unique référence. Partager le pouvoir est vécu comme une perte de statut — pas comme un investissement dans la solidité de l’ensemble.
—
Le contraste avec d’autres contextes
Le contraste est instructif si l’on regarde certains pays voisins — ou même nos diasporas.
On observe, ailleurs, des structures politiques plus durables, des organisations sociales plus consolidées, une gestion plus formalisée des conflits internes. Dans nos diasporas — en France, aux États-Unis, au Canada — des Camerounais parviennent à faire vivre des associations, des entreprises, des structures culturelles qui durent souvent davantage que celles construites au pays.
Pourquoi ? Parce que les conditions changent : risque politique moindre, institutions plus prévisibles, règles plus stables, ou simplement distance géographique imposant plus de dépendance mutuelle. Mais surtout parce que certains groupes développent volontairement une culture de la collaboration : règles explicites, procédures respectées, gestion transparente des désaccords, alternance ritualisée.
Autrement dit : la coopération durable n’est pas un miracle. C’est une discipline.
—
L’impératif stratégique
Pourtant, l’histoire — économique, politique, sociale — est sans équivoque :
aucune transformation majeure ne s’est jamais accomplie sans coopération durable.
L’union n’est pas un slogan naïf : c’est un levier de puissance. Les empires commerciaux se construisent par accumulation de capital — pas seulement financier, mais humain et institutionnel. Les mouvements politiques qui changent le cours des choses le font par des structures enracinées, des relais de générations, une construction patiente de légitimité collective.
La collaboration dans la durée n’est pas un luxe : c’est la seule façon de peser face à des systèmes puissants, organisés et persistants — qu’il s’agisse de l’État, des monopoles économiques ou des structures globales qui encadrent nos marges de manœuvre.
—
Au-delà des mythes du leadership
Le développement — comme le changement politique et social — n’est presque jamais l’œuvre de génies solitaires. Il est le produit de collectifs capables de dépasser les égos, de partager le pouvoir, de gérer les conflits et de tenir dans le temps.
Tant que nous confondrons leadership et domination personnelle, autonomie et isolement, pluralité et dispersion, nous resterons prisonniers de cycles de recommencements stériles. Tant que nous valoriserons le tribun charismatique au détriment du bâtisseur humble, l’initiative spectaculaire au lieu de l’accumulation patiente, nous replanterons sans jamais récolter.
—
Le véritable défi
Le véritable défi n’est donc pas de produire davantage d’initiatives.
Il est d’apprendre à les relier, à les consolider, à les faire durer.
Il est de construire des espaces où le désaccord n’équivaut pas à rupture, où l’alternance est prévue et acceptée, où l’intérêt commun prime sans écraser les particularismes. Il est de cultiver une culture de l’institution — non comme prison bureaucratique, mais comme socle qui permet à chacun de contribuer sans être absorbé, humilié ou effacé.
Cette collaboration n’est pas une prière. C’est une technique à maîtriser. Une discipline à apprendre. Une bataille quotidienne contre nos réflexes d’isolement.
Elle commence quand nous acceptons que ce que nous perdons en contrôle, nous le gagnons en puissance.
Elle s’enracine quand nous comprenons que l’autre n’est pas d’abord un rival, mais un multiplicateur de capacités.
Elle triomphe lorsque nous bâtissons ensemble — lentement, laborieusement, courageusement — les institutions durables qui seules peuvent transformer une nation.
#NousAvonsLeChoix
#NousAvonsLePouvoir
#ÉducationCitoyenne
#AllumonsNosCerveaux