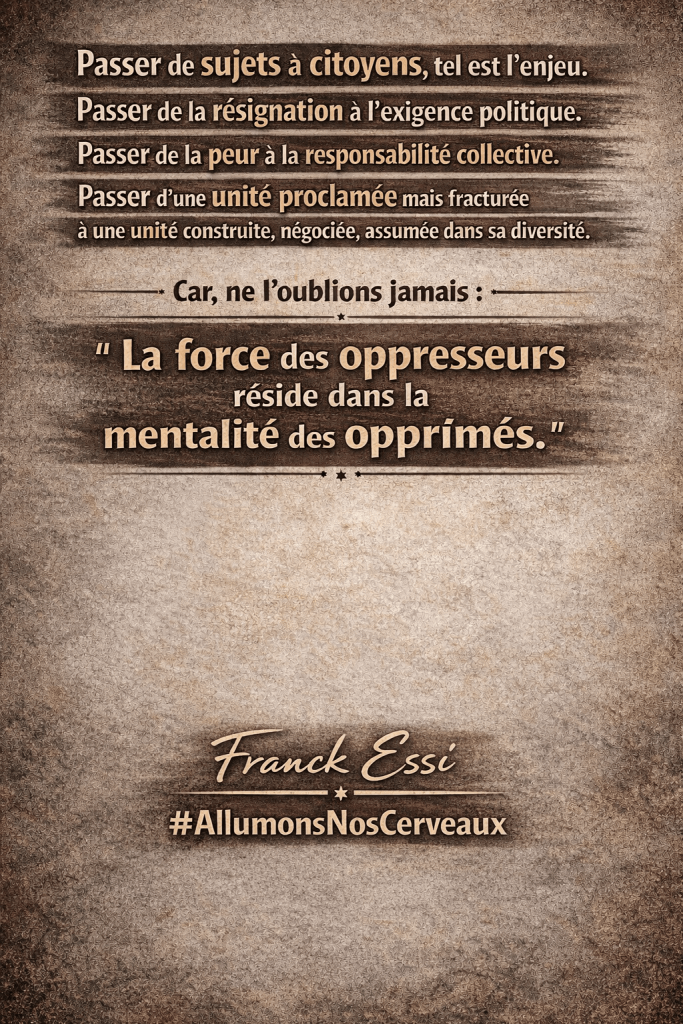Trente ans de révision constitutionnelle : la démocratie promise, le pouvoir confisqué
Par Franck Essi
—
Au milieu des années 1990, sous la pression conjuguée des mobilisations populaires africaines et d’un contexte international désormais favorable aux thèses de la démocratie libérale, le Cameroun engagea une réforme de son ordre politique. Le retour au multipartisme, la reconnaissance des libertés d’association et l’ouverture relative de l’espace public furent les premiers signes visibles de cette mutation.
La Constitution du 18 janvier 1996 devait en constituer l’aboutissement juridique et symbolique : un nouveau pacte entre l’État et les citoyens, fondé sur l’équilibre des pouvoirs, la décentralisation, la limitation du pouvoir exécutif, la souveraineté populaire, et la reconnaissance harmonieuse de la double identité politique, juridique et culturelle du pays — anglophone et francophone.
Trente ans plus tard, le bilan est sévère. Les promesses contenues dans ce texte apparaissent largement inabouties. Les germes démocratiques qu’il portait sont restés, pour l’essentiel, morts‑nés.
Ce qui s’est progressivement mis en place, ce n’est pas une transition démocratique, mais une forme de constitutionnalisme autoritaire : un système où l’on emprunte le langage et les formes de la démocratie constitutionnelle, tout en organisant, dans la pratique, la neutralisation méthodique des contre‑pouvoirs. La non‑mise en œuvre effective et à temps de la décentralisation, pourtant pensée comme facteur accélérateur du développement, ainsi que la non‑application équilibrée des deux dimensions de notre identité — anglophone et francophone — ont engendré des crises politico‑sécuritaires inédites, dont les effets fissurent désormais le pacte national lui‑même.
Le Cameroun a ainsi connu une révolution conservatrice rampante : des réformes institutionnelles en apparence, mais une conservation en profondeur des rapports de pouvoir. Le multipartisme est devenu un décor institutionnel, sans prise réelle sur les dynamiques politiques, économiques, sociales et identitaires qui structurent le pays.
Ces trente années d’application sélective — ou de non‑application assumée — de la Constitution ont été marquées par plusieurs dynamiques lourdes : la concentration croissante du pouvoir présidentiel ; l’instrumentalisation du droit à des fins politiques ; la mise en œuvre partielle et différée des institutions prévues par le texte fondamental ; la banalisation de l’exception sécuritaire ; l’affaiblissement progressif de la citoyenneté ; et, désormais, une fragmentation nationale sans précédent.
C’est à la lumière de ces dynamiques qu’il convient d’examiner ce que sont devenues, en pratique, les grandes promesses constitutionnelles de 1996.
—
La fin de la limitation des mandats : la confiscation constitutionnelle du pouvoir
(Article 6, alinéa 2)
La révision constitutionnelle de 2008 constitue un tournant majeur. La Constitution de 1996 prévoyait un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable une seule fois. En supprimant cette borne, la révision de 2008 fait sauter l’un des principaux garde‑fous arrachés par les luttes démocratiques des années 1990 : l’idée que l’alternance n’est pas un accident, mais un principe structurant de la vie politique.
Désormais, le mandat présidentiel est simplement « renouvelable », ouvrant la voie à une présidence à durée indéfinie. Le verrou n’est plus juridique ; il devient purement politique, dans un système où tous les leviers institutionnels sont déjà concentrés entre les mains de l’exécutif.
Depuis lors, les échéances électorales de 2011, 2018 et 2025 se sont déroulées dans un cadre institutionnel profondément déséquilibré : absence de réforme électorale crédible, administration électorale sous contrôle politique, restriction des libertés publiques, judiciarisation de la compétition politique.
Le discours officiel invoque la souveraineté du peuple. Mais comment parler de choix libre lorsque les conditions mêmes du choix sont structurellement faussées ? La suppression de la limitation du nombre de mandats n’a pas élargi la démocratie ; elle a consacré un régime d’élection sans alternance, où le scrutin sert d’habillage périodique à un pouvoir personnel.
Ce changement est allé, selon l’expression consacrée, dans le mauvais sens de l’Histoire.
—
L’immunité perpétuelle : l’irresponsabilité constitutionnalisée
(Article 53)
La même révision de 2008 a consolidé un second verrou : l’irresponsabilité politique quasi totale du chef de l’État pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Formellement, la Constitution prévoit que le Président de la République peut être mis en accusation devant la Haute Cour de Justice pour haute trahison et certains crimes. En apparence, il ne s’agit donc pas d’une immunité absolue, mais d’une responsabilité encadrée.
En réalité, ce mécanisme est inopérant. La Haute Cour de Justice, pourtant prévue par la Constitution, demeure une institution fantôme, renvoyée indéfiniment aux calendes grecques. Aucun dispositif politique concret ne permet d’engager un véritable procès du chef de l’État ou de son premier cercle.
Dans un pays marqué par l’explosion des scandales financiers, l’emprisonnement régulier de hauts responsables et la banalisation des détournements de fonds publics, cette irresponsabilité de fait apparaît comme une assurance contre toute reddition de comptes future.
Deux proverbes populaires éclairent cette réalité politique :
« Qui tue par l’épée mourra par l’épée » ;
« Ceux qui se ressemblent marchent ensemble ».
Pour échapper à cette logique de responsabilité historique, le pouvoir s’est doté d’un bouclier constitutionnel. Se dessine ainsi une conception monarchique du pouvoir : hors du pouvoir, point de salut ; hors de l’immunité, point de sécurité.
—
Le Sénat et la décentralisation inversée
(Articles 55 à 62)
La Constitution de 1996 avait inscrit la décentralisation comme un principe fondamental de l’organisation de l’État. Elle pouvait se concevoir comme une maison :
- Les communes décentralisées en constituent les fondations ;
- Les régions en sont les murs ;
- Le Sénat en est le toit.
Or, au Cameroun, le toit a été posé avant que les murs ne soient élevés et que les fondations ne soient consolidées. Le Sénat a été installé en 2013, alors que les régions n’étaient pas encore fonctionnelles et que les communes ne disposaient ni de compétences réelles ni de ressources suffisantes.
Plus grave encore, les sénateurs ont été élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux dont la légitimité politique était déjà épuisée, dans un contexte où la participation électorale est structurellement faible et la compétition verrouillée. La décentralisation s’est ainsi construite sur une base juridiquement légale mais politiquement illégitime.
Ce n’est qu’en 2020, sous la pression conjuguée de la crise anglophone et des injonctions internationales, que les régions ont été mises en place, vingt‑quatre ans après la Constitution. Mais ces nouvelles institutions demeurent sous tutelle étroite de l’État central, privées de marges d’autonomie significatives, notamment sur le plan fiscal.
En renvoyant sans cesse la décentralisation à plus tard, le pouvoir a retardé un des leviers majeurs du développement économique et social. La proximité de la décision, la responsabilisation des acteurs locaux, l’adaptation des politiques aux réalités des territoires sont restées des slogans. Le résultat est double : un pays administré de manière centralisée et inefficace, et des frustrations locales qui se transforment en colères politiques.
La décentralisation inscrite dans le texte s’est muée, dans la pratique, en simple déconcentration bureaucratique. On déplace des bureaux, pas du pouvoir. Et l’on bloque, ce faisant, un moteur essentiel de développement équilibré du territoire.
—
Le serpent de mer de la déclaration des biens
(Article 66)
Depuis 1982, le discours officiel promet la rigueur et la moralisation de la vie publique. La Constitution de 1996 a donné à ces promesses une traduction juridique claire : l’article 66, qui impose la déclaration des biens aux responsables publics.
Une loi organique a bien été adoptée pour préciser les modalités d’application. Sur le papier, les instruments existent. Dans la réalité, l’obligation reste largement théorique. La très grande majorité des responsables soumis à cette contrainte ne se conforme pas à la loi, sans que cela n’emporte la moindre conséquence politique ou judiciaire.
À la place, un empilement d’institutions a vu le jour : Commission nationale anti‑corruption (CONAC), Agence nationale d’investigation financière (ANIF), Tribunal criminel spécial, Cour des comptes. Les dispositifs se multiplient, les rapports s’accumulent, mais la corruption persiste. Les rapports officiels eux‑mêmes en témoignent, tout comme les classements internationaux.
Pourquoi ne pas appliquer une mesure simple, claire et préventive ?
Pourquoi refuser la transparence sur l’enrichissement des gouvernants ?
La réponse est politique : la lutte contre la corruption est proclamée, mais rarement pratiquée. Comme le dit l’image populaire, le loup peut se couvrir de plumes, il ne deviendra jamais un poulet.
—
Le Conseil constitutionnel : gardien du texte, garant du statu quo
(Article 46)
Inscrit dans la Constitution de 1996, le Conseil constitutionnel n’a été installé qu’en 2018. Vingt‑deux ans de latence pour mettre en place l’organe chargé de veiller à la suprématie de la loi fondamentale : ce délai, à lui seul, dit quelque chose de la place réelle accordée au contrôle de constitutionnalité dans l’architecture du pouvoir.
Depuis son installation, le Conseil constitutionnel est devenu un acteur central des contentieux électoraux. Il a entre ses mains la validation ou l’invalidation des résultats, l’arbitrage suprême des réclamations, la lecture officielle de la volonté populaire.
Mais loin d’incarner un contre‑pouvoir, il s’est affirmé comme un instrument de validation du statu quo. Ses décisions successives, en 2018 comme en 2025, ont systématiquement conforté les résultats proclamés par l’exécutif, malgré les preuves nombreuses d’irrégularités et les contestations argumentées de l’opposition et de la société civile.
Ainsi, même les mécanismes censés protéger la Constitution participent désormais à son instrumentalisation : la forme du droit est respectée, l’esprit du texte est détourné.
—
L’état d’exception permanent : la Constitution suspendue
Depuis 2016, la crise dans les régions anglophones a fait entrer le Cameroun dans une nouvelle phase : celle de la généralisation de l’exception sécuritaire.
Arrestations massives, civils jugés par des tribunaux militaires, restrictions des libertés publiques, coupures d’Internet, militarisation du quotidien : autant de pratiques qui ont progressivement relégué la Constitution au second plan, bien au‑delà des seules régions en conflit.
Certes, l’instrumentalisation de la sécurité n’est pas nouvelle. Mais ce qui s’est installé au cours de cette décennie, c’est la normalisation de l’exception : l’idée que la menace sécuritaire — réelle, grave — justifie durablement la suspension des droits, plutôt que l’exigence de restaurer l’État de droit comme condition de la sécurité elle‑même.
Au cœur de cette crise, une dimension fondamentale de la Constitution a été trahie : la reconnaissance de la double identité du Cameroun, anglophone et francophone, comme richesse à protéger et organiser. Au lieu de gérer cette dualité par le dialogue, le respect des spécificités juridiques, éducatives, administratives, le pouvoir a opté pour la force, la centralisation et l’assimilation. La conséquence est une crise politico‑sécuritaire inédite, qui dure depuis plus de dix ans et qui a profondément abîmé le lien de confiance entre une partie du pays et l’État central.
Là encore, la Constitution est convoquée, contournée, redéfinie au gré des décrets et des lois d’exception. Elle devient un texte que l’on sort ou que l’on range selon les besoins du moment.
—
Trente ans de révolution conservatrice
Quatre tendances lourdes se dégagent de ces trente années constitutionnelles.
La première est celle d’une révolution conservatrice permanente. Chaque réforme institutionnelle est conçue non pour transformer le système, mais pour le préserver. On change les textes pour que le régime reste, au fond, le même. La révision de 2008 en est l’illustration la plus brutale : un usage du pouvoir constituant dérivé pour verrouiller le pouvoir constitué.
La deuxième est la concentration extrême du pouvoir. L’exécutif domine le législatif, dont une large partie n’est que courroie de transmission. Le judiciaire demeure dépendant, à travers les nominations, les carrières, les pressions directes et indirectes. Les contre‑pouvoirs institutionnels — Conseil constitutionnel, Cour des comptes, institutions de contrôle — sont intégrés à l’architecture de domination plutôt qu’opposés à elle.
La troisième est l’affaiblissement de la citoyenneté. Le peuple est réduit à un rôle électoral intermittent, sans réelle capacité de contrôle des gouvernants entre deux scrutins. L’éducation civique est dévoyée, les médias sont encadrés, l’opposition est criminalisée, les syndicats et associations sont surveillés ou cooptés. La souveraineté populaire, proclamée dans le préambule, est progressivement vidée de sa substance.
La quatrième tendance est celle d’un pays plus divisé que jamais. La non‑mise en œuvre effective et à temps de la décentralisation, qui aurait pu corriger les déséquilibres territoriaux et donner un contenu concret au développement local, a laissé s’installer un sentiment d’abandon et d’injustice dans de nombreux espaces. La non‑application équilibrée des deux dimensions de notre identité — anglophone et francophone — a transformé une richesse historique en fracture politique. Les crises politico‑sécuritaires qui couvent ou éclatent depuis plus de dix ans, au Nord comme à l’Ouest, dans les villes comme dans les campagnes, sont le symptôme d’un pays qui n’a jamais vraiment assumé son pluralisme, ni sur le plan territorial, ni sur le plan identitaire.
Au cœur de ce dispositif, la Constitution joue un rôle paradoxal. Elle n’est pas seulement ignorée ; elle est performée contre elle‑même. On gouverne au nom de la Constitution, tout en organisant, par des lois, des pratiques administratives et des décisions judiciaires, la mise à distance de ses principes fondateurs — y compris ceux qui garantissent l’égalité des citoyens devant l’État, quelle que soit leur région, leur langue ou leur héritage juridique.
—
De la Constitution confisquée à la refondation nécessaire
La Constitution de 1996 n’a pas échoué par accident. Elle a été progressivement vidée de son esprit par une application sélective, calculée, politicienne de ses dispositions. Le Cameroun ne souffre pas d’un manque de textes, mais d’un usage stratégique du droit comme instrument de conservation du pouvoir et de gestion autoritaire des diversités.
Dès lors, il ne s’agit plus seulement de corriger quelques articles isolés. Les retouches techniques ne suffiront pas. C’est le pacte politique lui‑même qu’il faut reconstruire, dans le cadre d’une transition démocratique refondatrice, fondée sur :
- La limitation effective du pouvoir, par un retour à une véritable limitation des mandats et la fin de la présidence à vie de fait ;
- La responsabilité réelle des gouvernants, par la mise en fonctionnement des mécanismes de reddition de comptes (Haute Cour de Justice, article 66, justice indépendante) ;
- L’équilibre concret des institutions, par la garantie de l’indépendance du juge, l’autonomie de l’organe de gestion des élections, la décentralisation réelle avec des ressources et des compétences ;
- La souveraineté citoyenne, par la protection des libertés publiques, la sécurisation de la participation politique et le contrôle populaire des élus ;
- La reconnaissance assumée et institutionnalisée de notre double identité anglophone et francophone, non comme une menace à neutraliser, mais comme un socle à partir duquel refonder l’unité nationale sur la justice, le respect et l’égalité.
Passer de sujets à citoyens, tel est l’enjeu.
Passer de la résignation à l’exigence politique.
Passer de la peur à la responsabilité collective.
Passer d’une unité proclamée mais fracturée à une unité construite, négociée, assumée dans sa diversité.
Car, ne l’oublions jamais :
La force des oppresseurs réside dans la mentalité des opprimés.
Tout l’enjeu des prochaines années sera de briser cette mentalité, pour que la Constitution cesse d’être un texte confisqué et devienne enfin ce qu’elle aurait dû être dès 1996 : l’expression vivante d’un peuple qui se gouverne lui‑même, dans toutes ses régions, dans toutes ses langues, dans toute sa diversité.
#AllumonsNosCerveaux